Jean-Michel Delacomptée, Lettre de consolation à un ami écrivain
aux éditions Robert Laffont, septembre 2016, 160 pages, 16 €
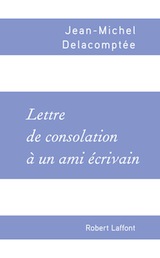 Cette lettre de petit format, qui se lit en une heure, relève du pamphlet. À partir d’une circonstance, un ami dépité par le silence de la presse devant sa littérature, Jean-Michel Delacomptée, pour consoler, dévide un fil d’explications. En préalable, vu que « le pays marche de travers, perclus de rhumatismes, bourré de sédatifs et d’anxiolytiques, victime de nausées, de vertiges, ravagé de frustrations, de rages, de peurs et d’angoisses », le recul de la littérature resterait secondaire, si la quasi disparition de celle-ci n’accompagnait pas d’autres renoncements.
Cette lettre de petit format, qui se lit en une heure, relève du pamphlet. À partir d’une circonstance, un ami dépité par le silence de la presse devant sa littérature, Jean-Michel Delacomptée, pour consoler, dévide un fil d’explications. En préalable, vu que « le pays marche de travers, perclus de rhumatismes, bourré de sédatifs et d’anxiolytiques, victime de nausées, de vertiges, ravagé de frustrations, de rages, de peurs et d’angoisses », le recul de la littérature resterait secondaire, si la quasi disparition de celle-ci n’accompagnait pas d’autres renoncements.
Pour sa démonstration, Jean-Michel Delacomptée oppose le document qui vaut par ce qu’il traite, un rapport sur l’enfermement par exemple, à la littérature qui vaut par la façon dont elle traite un sujet. Il définit cette dernière par ce qui la traverse, une part de poésie, c’est-à-dire d’infini, de suggestion, de double-fond même, qui habite tout autre chose qu’une notice d’information ou d’entretien. Le dévoilement d’une conscience n’est-il pas autrement utile qu’un constat d’huissier ? « La littérature ne visait pas à photographier le réel, mais à le révéler par l’alchimie des mots. » On notera l’imparfait du verbe, “visait”, de même que la poésie n’existe plus que pour les aveugles. Elle a disparu du paysage. Ce qui se vend peu ne garantit pas pour autant une qualité ni l’authenticité attendue.
Prenant du recul, il revisite la lutte des Anciens et des Modernes, avec brio. Sans remonter après lui au M. Â. ou à La Princesse de Clèves, qui modèle une part de notre identité, force est de rappeler que les années cinquante avaient vu fleurir le slogan d’une nouvelle littérature, abstraite et formaliste, contre laquelle Gracq a vaticiné, sans plus gagner que Jourde cinquante ans plus tard. Il observe que de nos jours « le roman est devenu la continuation du journalisme par d’autres moyens, comme la sociologie, la psychologie ». Avec les succès de la littérature policière et des séries télévisées, à quoi s’ajoute la corruption intellectuelle qui vaut bien les autres, écrit Delacomptée, les notions d’effort, d’intériorité, de vertu et donc de style ont été pulvérisées. « Le triomphe du people a tué la vérité. Les ravages du petit écran sont incalculables, machine à inverser les valeurs, et la presse écrite n’a pu résister. »
La presse écrite, en perte d’audience, en effet suit la télévision. L’esprit du public est ainsi formaté que tout exige de la facilité. L’action prime la réflexion, tout à trac traitée au rondup. Le vraisemblable est caduc, seul compte le vrai que tout le monde devrait authentifier. On examinait un for intérieur, on nous livre un regard brut et brutal de préférence. On appelle ça du docu-fiction, pourquoi pas des dommages collatéraux ? « Le nouvel art romanesque consiste dans le rejet de l’art [rabaissé] au rang d’artifice, de superflu, d’oppression, d’élitisme, bref, de bourgeois. » C’est la position d’Annie Ernaux que beaucoup de monde applaudit. Quand à la Duras du pauvre, qu’elle se réconcilie avec sa mère, et le cru de son viol émoustille encore les masses à son judas.
Le succès de ce type de « roman à fond plat », s’il a « déserté le camp de la littérature », engendre des effets qui collent à la faillite de l’école. Niée avec aplomb, celle-ci est avérée depuis trente ans. Comme pour la littérature de jeunesse, « l’ensemble du vocabulaire tient sur un ticket de métro. » Les clichés pullulent, sans vergogne, dans le même temps que les images sont bannies, pour aller plus vite, pour dire plus crûment des pacotilles. « Le roman n’a plus confiance dans les mots à l’instar de toute la société, mots usés par la com’, par la pub, par la contrefaçon généralisée, par la dictature du mensonge. » Cette Lettre est roborative.
Pierre Perrin, note du 8 octobre, parue sur La Cause littéraire le 17 novembre 2016 [supprimé depuis]
- Les pages de lancement pour 100 notes de lecture sur Le Frais Regard
- Paloma Hidalgo – Canetti & Goldberg – Paul Valéry – J.-F. Migeot
- Jean-François Mathé – Richard Millet – Sabine Huynh – Alain Duault
- René de Ceccatty – Paul Gadenne – Claire Fourrier – Catherine Dutigny
- Claire Boitel [deux titres] – Domi Bergougnoux – Jean-Pierre Siméon [deux titres]
- S. Tesson – V. Megglé – C.-A. Planchon – C. Krähenbühl et D. Mützenberg –
- Jérôme Garcin – A. Nouvel – J.-M. Delacomptée – M. Compère-Demarcy –
- – Céline Debayle – Jean-Jacques Nuel – Mathilde Bonazzi – Éric Brogniet –
- – Patrick Grainville – Didier Pobel – Stéphanie Dupays – Ariane Bois –
- – Carole Zalberg – Éric Poindron – Jacques Réda – M. Compère-Demarcy –
- Pierre Jourde – Gwenaële Robert – W. B. Yeats – George Orwell –
- J.-F. Mathé – André Blanchard – Jean-Michel Delacomptée – Sophie Calle –
- A. Baldacchino – Jean-Pierre Siméon – Marie Murski – Emma. Delacomptée –
- Gwenaële Robert – Marc Villemain – Marc Dugain – Éric Brogniet –
- Jean-Michel Delacomptée – Éric Poindron – Michel Baglin – Patricia Suescum
- Jean-Marie Kerwich – Nimrod – Richard Millet – Jean-Pierre Poccioni
- Francesco Pittau – La Revue littéraire – Alain Nouvel – Jean Le Boel
- A.C. Rodriguez – Jean-Claude Pirotte – E. Delacomptée – Gérard Chaliand
- J.M. Delacomptée – Jean-Yves Masson – Jacques Réda – François Laur
- Thierry Radière – Natacha Appanah – Louisiane C. Dor – Jean-Pierre Georges
- Adeline Baldacchino – Franck Balandier – Adrien Goetz – Estelle Fenzy
- Guy Goffette – Adeline Baldacchino – Claire Fourier – J.-Claude Martin
- Frédéric Tison – J. Viallebesset – Dom. Sampiero – Pat. Delbourg
- Sophie Pujas – A. Baldacchino – Marlène Tissot – S. Rotil-Tiefenbach
- J.M. Maulpoix – Sophie Pujas – Philippe Delaveau – J.M. Delacomptée
 et 12 entrées choisies
et 12 entrées choisies de la revue papier
de la revue papier Les
Les  critiques
critiques

