Adeline Baldacchino, Michel Onfray ou l’intuition du monde
essai, Le Passeur, 2016, 240 pages, 18 €
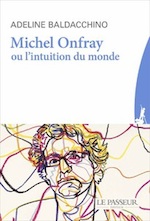 « Ils condamnent par avance ce qu’ils ne connaissent pas encore. » C’est vrai que Michel Onfray en effraie plus d’un, parmi ceux qui ne l’ont pas lu. Adeline Baldacchino, qui écrit laisser « les empailleurs de vivants, les critiques empaillés » derrière elle, dresse un beau portrait du poète, « héritier présomptif de Bachelard », qu’elle donne à découvrir au revers de la médaille du philosophe. « Il faut une colonne vertébrale au poète, une chair au philosophe. » Les vers cités ne sont pas légion ; pourtant ils sont beaux. C’est par lui-même que cet essai, construit sur trois piliers que figurent le poétique, l’érotique et l’éthique, offre une fête pour l’esprit. Par la clarté du propos, la richesse de la réflexion et l’étendue des sources, chacun s’y trouve projeté durablement au cœur de soi. Adeline Baldacchino réalise un « exercice d’admiration assumé et [une] tentative d’en discerner les ressorts » avec brio.
« Ils condamnent par avance ce qu’ils ne connaissent pas encore. » C’est vrai que Michel Onfray en effraie plus d’un, parmi ceux qui ne l’ont pas lu. Adeline Baldacchino, qui écrit laisser « les empailleurs de vivants, les critiques empaillés » derrière elle, dresse un beau portrait du poète, « héritier présomptif de Bachelard », qu’elle donne à découvrir au revers de la médaille du philosophe. « Il faut une colonne vertébrale au poète, une chair au philosophe. » Les vers cités ne sont pas légion ; pourtant ils sont beaux. C’est par lui-même que cet essai, construit sur trois piliers que figurent le poétique, l’érotique et l’éthique, offre une fête pour l’esprit. Par la clarté du propos, la richesse de la réflexion et l’étendue des sources, chacun s’y trouve projeté durablement au cœur de soi. Adeline Baldacchino réalise un « exercice d’admiration assumé et [une] tentative d’en discerner les ressorts » avec brio.
D’entrée, elle explique son choix, sans cacher ses mobiles biographiques. Ce qu’elle a trouvé chez l’aîné, poète, c’est « une voix nimbée d’incertitude […] une brèche heureuse dans l’édifice conceptuel […] sensible aux polysémies de la douleur » et, pour elle, le moyen de comprendre peut-être « le complexe de l’ogre ». Du côté de la vie, l’enjeu est clairement fixé :« la survie passe par une langue qui vient combattre les forces nocturnes » ; du côté de la poésie, le camp est choisi : « Le poème ne gagne rien dans les parages de l’obscurité. » Les deux côtés ne sont-ils pas au vrai intimement liés ? « Le poème ne ramène pas de la mort ni n’évite d’y aller, Orphée l’a bien compris. Il ne jette aucun sort. Il sait bien qu’on peut se passer de lui, l’oublier, le souiller, blasphémer sur son texte sans conséquences. Il n’a pas besoin d’Inquisition ni de brigade pour faire respecter ses injonctions qui n’en sont pas. Il est, dans l’ordre du réel qui est un ordre fragile, le souvenir d’une magie qui se saurait faillible et pauvre. » Une telle pensée rappelle que Montaigne disait déjà : la poésie, « c’est l’originel langage des dieux », Essais, III, chapitre IX, qu’on peut comprendre comme une prière.
Adeline Baldacchino n’hésite pas à « renvoyer dos à dos les fascinés de la chose-en-soi et les pervers du texte tout seul, les fous du fond et les hystériques de la forme. Le poème n’a rien de sacré, le poème n’a rien de secret ». Elle rappelle Meschonnic : « Le poème est ce qu’un corps fait au langage. » Pour le poète, elle insiste donc sur la nécessité de l’émotion originelle, de la charge d’existence, de « ce qui vaut d’être vécu avant d’être perdu ». Elle résume cela dans cette formule : « La lumière ne s’atteint que par imprégnation du monde. » Un chapitre entier célèbre l’amour, tire ce dernier vers la perfection, aiguise le regard. Non seulement elle dit ce que le plaisir féminin peut-être, devrait être dans le regard des hommes, ce qu’on trouve rarement exprimé de la sorte, mais elle sait aussi mettre en mots le résultat de « la coïncidence des désirs pareille au miracle du mot juste, inscrite dans le battement de cœur et dans le sourire, dans la transpiration des mains jointes […] Stendhal le disait déjà : “Dans l’amour véritable, c’est l’âme qui enveloppe le corps” ».
Dans sa partie “éthique”, elle démontre enfin comment la poésie – dont Jean-Pierre Siméon a écrit, chez le même éditeur, qu’elle sauvera le monde – peut « défaire les sangles de la pensée […] Le poète est l’anti-perroquet de toutes les proses ». La poésie remettant en cause la brutalité consumériste, « les mots [du poème] ont vocation à changer la vie ». Comment ? Elle cite Bobin : « Un poète ne donne pas ce qu’il pense (c’est sans intérêt) mais ce qu’il est. » C’est pourquoi le poème devient « un conservatoire des étincelles ». Elle consigne encore cette vérité : « Le temps n’est constitué que de fines pointes – révélées parfois par la poésie lorsqu’elle est à son plus haut – qu’il nous appartient de rassembler pour nous donner un instant de fixité. » Ce bel essai contenant ce jugement, il faut le lui attribuer, tant il le mérite totalement : « L’œuvre donne soif ; elle ne clôt pas le débat, elle l’invente. »
Pierre Perrin, note du 14 mars parue sur La Cause littéraire [supprimé depuis], le 20 avril 2016
 et 12 entrées choisies
et 12 entrées choisies de la revue papier
de la revue papier Les
Les  critiques
critiques

